
Parijs
- 19e eeuw ![]() Joseph Méry
Joseph Méry ![]() La Comédie des animaux
La Comédie des animaux
 |
|
CuBra |
|
1862
Saisie
du texte : S. Pestel pour la collection électronique de Texte
relu par : A. Guézou http://www.bmlisieux.com/ Texte
établi sur un exemplaire (coll. particulière) de l'édition
Bossard de Quatre
nouvelles humoristiques parue
en 1922 dans
Oorspronkelijk
verschenen in La Comédie des animaux, histoire naturelle en
action, 1862 |
Un chat, deux chiens, une perruche, un nuage d'hirondelles I. Moeurs des perroquets et des perruches. Pourquoi ils vivent avec les hommes. Histoire authentique. Saint-Leu-Taverny. Paysages. A quoi me sert ma perruche. Comment les cages s'ouvrent.
Une députation d'enfants. Une expédition où je ne reste pas au-dessous du sultan Amurat IV. Trop tard ! Discussion parlementaire... et anecdotique. Le chat du musée de Marseille. Sa
mort et sa L'Horloge
du Musée. Annibal, Fernand distancés
par un quadrupède.
Saint-Leu-Taverny,
1er Octobre 1854.
Le
perroquet est une erreur de la nature, erreur qui a été corrigée
par la perruche. Nous
parlerons un jour de la perruche multicolore, la plus belle fleur
vivante de
l'Inde. Aujourd'hui, il s'agit de la perruche verte, cet oiseau à
collier qui a
le don de la parole comme le perroquet, et n'en abuse pas pour pousser
des cris
intolérables, dignes d'un ténor applaudi. Il
est triste de le dire, mais la vérité avant tout : si les perroquets
et les perruches
se trouvent à leur aise dans la société des hommes ; s'ils les regardent
comme de vieilles connaissances ; s'ils leur demandent l'aumône du déjeuner
avec un ton de voix si mielleux, c'est que la nature a destiné ces oiseaux
à vivre dans la société des quadrumanes. Sans éducation première,
tout animal
aime ou redoute ce que ses instincts lui conseillent d'affectionner ou
de craindre.
Les perroquets et les perruches sont les parasites des singes ; ils volent
sans cesse autour des arbres où ces histrions des bois brisent les écorces
des fruits, dévastent l'arbre à pain, cassent les noix de coco ; ces
oiseaux
parleurs, dont le bec est trop faible pour un pareil travail,
ramassent les
miettes du festin, et, instruits à l'école oratoire des singes, ils
les remercient
en imitant leurs cris, et leur disent, comme ils peuvent, qu'ils ont très
bien déjeuné. Ainsi,
le bon accueil que ces oiseaux font à l'homme n'est pas très
flatteur pour
le genre humain. Il est vrai de dire aussi qu'une perruche ne peut
avoir dans
l'oeil cette délicatesse de goût qui fait distinguer un vieux faune
de l'Apollon
du Belvédère. Peut-être encore l'oiseau reconnaît que l'homme est
plus beau
que le singe ; raison de plus alors pour lui de rechercher sa société
avec plus
de plaisir. Ce qu'il y a de positif, c'est que les oiseaux qui n'ont
pas besoin
des singes pour vivre avec luxe, sont très timides et redoutent
l'homme comme
un vautour aptère, c'est-à-dire non ailé. Les
perroquets et les perruches ont, dans les bois, les moeurs gourmandes
que nous
leur connaissons dans les villes, sur leurs perchoirs. Ils ne se
contentent pas
du repas frugal de la graine ; ils convoitent tout ; ils s'agitent
devant toutes
les friandises ; ils demandent à goûter chaque plat qui passe sur
une table
; ils aiment, par gourmandise inassouvie, tout ce que l'homme paraît aimer.
Dans la vie libre des forêts indiennes, ces oiseaux ont sans doute
des appétits
plus voraces ; leur bec peut bien travailler une canne à sucre ou égrener
un épi de riz, mais la diversité dans les plats est leur passion dominante
; ils sont alors obligés à suivre, d'arbre en arbre, des quadrumanes
aussi
gourmands qu'eux et plus habiles à varier le festin. Ce
préliminaire était indispensable pour l'histoire que nous allons
raconter ; si
elle paraît fabuleuse, nous appellerons en témoignage tous les
habitants du village
de Saint-Leu-Taverny. Les pièces justificatives ne nous manqueront
pas. Vers
la fin de l'été dernier, j'habitais ce joli village de Saint-Leu.
J'adore cette
résidence champêtre, où rien ne rappelle la ville. On trouve là un
musée naturel
des originaux copiés par les illustres paysagistes de l'école du
Nord. Il
y a des Wynantz, avec leurs grands arbres découpés par d'étroites sémites
où passe
le chevrier ; il y a des Berghem, où la bergère à cotte rouge se détache
sur
un fond vert ; il y a des Ostade d'été ; des Demarne, où s'étendent
les grands
pâturages ; des Asselyn, aux horizons infinis ; des Jean Miel, avec
leurs scènes
rustiques ; des Jean Breughel, avec leurs forêts traversées par des caravanes
villageoises ; des Van-der-Neer, avec leurs clairs de lune solaires, qui
jouent sur la surface calme des eaux. C'est la nature septentrionale,
soeur de
l'autre, et toujours belle pourtant aux rayons de l'été. On y voit
aussi des lavoirs
dans les touffes de frênes, où de jeunes filles travaillent comme Andromaque
et Nausicaa, princesses du blanchissage, et suspendent le lin aux branches
d'un saule riant ; on y trouve des ruisseaux limpides qui courent les rues
; de vastes étables où des coqs se promènent fièrement comme des
rois dans un
palais ; des hôtelleries où le feu flamboie sous le manteau des
cheminées féodales
; et de tous côtés, par-dessus le toit des maisons basses ou par les
éclaircies
des carrefours, on aperçoit de gigantesques panaches d'arbres, des lambeaux
de forêts sombres, de jolis jardins où toutes les flores s'associent
pour
embaumer l'air et réjouir les yeux. Quand
on a beaucoup d'oiseaux en cage, on est obligé de les transporter à
la campagne.
Je conduisis donc les miens à Saint-Leu, pour les faire jouir de ce délicieux
paysage. J'aime
beaucoup les perruches, et malheureusement mon affection pour ces
oiseaux est
intéressée. Au fort de l'hiver de Paris, je me dis, comme
consolation, en regardant
ces oiseaux indiens : -
Ils vivent ici par dix degrés de froid, donc je puis y vivre. Mon
affection est d'un égoïsme révoltant. Il y a, d'ailleurs, beaucoup d'affections
comme celle-là, et dans lesquelles les perruches n'entrent pour rien. Entre
autres perruches de toutes couleurs dont Buffon ne parle pas, j'en ai
une très
jeune, très sauvage, et rétive à l 'éducation. Elle écoute les leçons
de toutes
les formules du répertoire de sa race, mais elle ne répète rien. Un
oiseleur
que j'ai consulté m'a dit : -
Il faut la mettre en pension chez un perroquet. Conseil
perfide ! elle en saurait trop. Elle
était donc à Saint-Leu, enfermée dans une cage du côté de la
campagne ; elle
jouissait d'une vue superbe ; un horizon de collines, de bois et de jardins,
et des fleurs partout, et des chants d'oiseaux sur les arbres, et pas un
orgue de Barbarie, pas une cavatine de roues d'omnibus. Un
jour arrive où les cages les mieux fermées s'ouvrent. Qui les a
ouvertes ? Est-ce
vous ? - Non. - Est-ce vous ? - Non. - Ma cage s'ouvrit donc d'elle-même,
et
la perruche prit au vol le grand chemin de l'air. Quand
ces catastrophes domestiques arrivent à Paris, on fait imprimer cinq
cents affiches
et on promet cinquante francs de récompense. Six mois se passent ; la
perruche
ne reparaît pas. On gagne cinquante francs. Ils servent à payer les affiches.
Tout n'est pas perdu. Ce
procédé n'est pas connu à Saint-Leu. Il y a un enfant qui exécute
très bien un
solo de tambour, convoque les passants sur la place de la mairie, sur
la place
de perdu,
promet une récompense honnête, et indique le domicile où on récompensera
honnêtement
la restitution. J'eus
donc recours à cet enfant ; il joua son rôle comme un homme sérieux
; il indiqua
le domicile de la perruche, rue du Château, 32. On
se mit à la recherche de tous les côtés. La
société parisienne et artiste au milieu de laquelle je me trouvais
à Saint-Leu
portait le plus vif intérêt à la perruche, et on désespérait généralement
de la revoir. Les
raisons que chacun donnait avaient une apparence spécieuse. A Paris, disait-on,
le premier commissionnaire du coin trouve une perruche envolée ; cet oiseau
ne voit que des maisons et n'entend que des omnibus, il ne demande pas
mieux
que de se laisser reprendre ; mais dans un village entouré de bois,
de jardins
et de fontaines, une perruche a retrouvé sa vie libre et ses
perchoirs naturels.
Nous ne la reverrons plus. Rien
n'est triste à l'oeil comme une grande cage qui a perdu son locataire
ailé ;
on y replace en imagination l'oiseau charmant ; on le voit sautiller
sur les barreaux,
lustrer ses plumes avec son bec, déployer toutes ses grâces d'ange, tressaillir
devant le grain de sucre offert par deux jolis doigts. L'absence couvre
de son deuil ce petit Eden grillé. On le regarde à travers des
larmes, et,
au moindre chant aérien, on croit que l'enfant prodigue va revenir. Pendant
quinze jours, le crieur exécuta trois fois ses solos de tambour ; personne
n'arrivait plus à l'appel ; il faisait sa proclamation dans le désert. J'entendais
dire à chaque instant ces lamentables paroles : -
Il faut en prendre le deuil ! Heureusement,
la chasse n'était pas ouverte. Les chasseurs sont sans pitié, les novices
surtout ; ils ne sont pas forts sur l'ornithologie ; au point du jour,
ils
peuvent confondre une perruche et un perdreau, et faire feu. Une sage
mesure de
police avait remis au 15 septembre l'ouverture de la chasse ; je ne
redoutais rien
encore de ce côté pendant un mois et demi. Un
jour, nous voyons arriver une députation d'enfants, rouges de sueur ;
le plus âgé
prit la parole et dit qu'on avait vu la perruche dans le parc du château
de Boissy. Toute
la députation affirma la chose, et elle s'offrit pour me conduire à
ce parc. -
Est-il bien éloigné ? demandai-je. Un
choeur enfantin répondit : -
Trois lieues. A
Saint-Leu, on n'a pas encore admis les kilomètres. On appelle même
le maire monsieur
le bailli. Le chemin de fer est très éloigné de Saint-Leu. -
Trois lieues ! repris-je, c'est un voyage, et la chaleur est très
forte aujourd'hui. Je
demandai aux enfants cinq minutes de réflexion ; on me les accorda. En
ce moment, je travaillais à mon Histoire de Constantinople, et j'étais
arrivé au
règne de Murad, ou Amurat IV (1635) ; le matin même j'avais écrit
cette longue
campagne d'Asie, lorsque ce glorieux sultan partit de Scutari pour
aller prendre
Bagdad, au mois de juillet. Il était jeune et charmant ; il habitait
un palais
délicieux sur le Bosphore ; il passait pour un dieu parmi les
croyants ; il
avait dans ses trésors toutes les richesses des Mille et Une Nuits,
et un beau
jour il abandonne tout pour traverser les déserts de feu, les vallons
de neige,
les fleuves sans ponts, les plaines sans eau, pour aller assiéger
Bagdad. Je
rougis de ma faiblesse devant un pareil exemple, et, n'ayant rien de
ce qu'avait
Murad IV, je me mis en campagne en plein midi, pour assiéger la perruche
dans un parc beaucoup moins éloigné que Bagdad. Les
enseignements de l'histoire sont fort utiles dans certaines occasions. Nous
traversions une plaine assez semblable à celle où Lucullus découvrit
les cerisiers.
Je marchais en tête des enfants, qui maraudaient selon l'usage des armées
à jeun et des écoliers en vacance. Nous
arrivâmes au parc de Boissy. Le jardinier de l'endroit, désireux
d'avoir la récompense
honnête, me désigna l'arbre où la perruche s'était montrée tous
les jours
précédents ; il me désigna aussi sur le gazon les graines de millet
et les débris
de pain, éparpillés par les enfants, qui jouaient le rôle de la Providence
; il me montra même le bassin d'eau limpide où l'oiseau fugitif se désaltérait
après ses repas ; il me montra tout enfin, excepté la perruche. Je me
rappelai les vers qu'Orphée adresse à Eurydice perdue ; je les
chantai sur un air
de Rossini ; les échos, qui ne sont jamais en peine de répondre, répondirent
seuls
à ma voix tout le long de la rivière : Toto
referebant flumine ripæ. Le
jardinier inclina la tête en me disant pour adieu l'éternelle phrase
des regrets
: -
Ah ! si vous étiez venu hier ! Je
n'étais pas venu hier ; le malheur de ce retard était incurable. Il
fallut pourtant
donner une légère gratification à ces enfants, qui avaient nourri
la perruche
à leurs frais pendant quinze jours. A
mon retour, je répondis par un silence morne aux questions qu'on
m'adressa. Il fut
admis unanimement que l'oiseau avait suivi, comme Mme Deshoulières,
les prés fleuris
qu'arrose l'arrêtait
pas en chemin. Quelques
jours après, Bernard, le conducteur d'omnibus de Franconville, vint nous
annoncer qu'il avait vu la perruche aux Plessis, à très peu de
distance de la
station. M. Decroix, épicier à Saint-Leu, nous confirma la même
chose. Ce fut pour
moi un trait de lumière ; je pris le ton inspiré d'un oracle de
Delphes, et je
dis : -
Maintenant, je vous affirme qu'avant un mois la perruche sera rentrée
dans ses foyers. On
me proposa des paris, je les tins, avec la légitime espérance de les
gagner. Un
soir, à la veillée, sous les arbres, on me demanda si je persistais
dans mes paris. -
Plus que jamais, répondis-je, et tout prêt à en engager de nouveaux. On
voulut connaître la cause secrète de ma conviction inébranlable ;
je cédai à ce
désir, et je débutai ainsi : -
Je puise ma conviction dans une histoire assez curieuse, qui a eu pour
théâtre le
musée de Marseille en comme
toute l'histoire naturelle, d'ailleurs... ; il s'agit d'un chat... A
ce mot, je fus interrompu comme un député à la tribune. On s'écria
en choeur qu'il
s'agissait d'une perruche et non d'un chat. Je
calmai d'un geste les interrupteurs et les jeunes interruptrices, et
je les priai
ensuite de vouloir bien attendre la fin. Tous
se turent, conticuere omnes, et je repris gravement : -
En 1842, il y avait, chez le gardien du musée de Marseille, un chat
très vieux et
très mélancolique ; il avait perdu toutes les habitudes de la petite
race féline
; il ne lustrait plus sa fourrure avec sa patte ; il ne prenait plus
de jolies
poses de sphinx ; il ne s'intéressait plus au sabbat de la cave ; il
ne se
mettait plus à la fenêtre pour voir passer les chiens ; tout lui était
indifférent.
Il avait l'air de méditer un suicide ; à Memphis, il y a quatre mille
ans, on aurait veillé sur lui ; mais, à notre époque, ces animaux
ont perdu
leur antique considération ; ils sont accusés de rendre le mal pour
le mal ;
et on leur préfère les chiens, parce qu'ils rendent une caresse pour
un coup de
pied. Les chats sont les victimes de leur logique et de leur justice. Quelques
personnes, douées encore du sens égyptien, rendent hommage à leurs nobles
qualités. Aux
yeux de certaines gens, les chats ont le tort de vieillir ; dès
qu'ils ne sont
plus jeunes, ils ne sont plus chats ; alors, on trame contre eux de ténébreux
complots ; on les regarde d'un air menaçant ; on leur prodigue les insultes,
et ces pauvres animaux cherchent un coin sombre pour y traîner les derniers
jours de leur vieillesse, et ils laissent lire dans leurs yeux à demi
fermés
et sur les rides de leur front, tout ce qu'ils pensent de
l'ingratitude des
hommes et des caprices des enfants. A
la suite d'un complot tenu dans le musée, il fut arrêté que le chat
de l'établissement,
coupable de vieillesse, serait mis dans un sac et confié à un paysan,
ami des chiens, lequel se chargeait gratuitement de le précipiter, du
haut
du Saut de Maroc, dans la mer. Le
Saut de Maroc est un rocher à pic, sur le chemin du village de Rove,
à trois lieues
de Marseille. Il y a une légende sur ce précipice ; je vous la raconterais
volontiers, mais, si nous nous embrouillons encore dans un épisode, nous
ne retrouverons plus la perruche au dénouement. Le
paysan s'acquitta, sans remords, de cette exécution. A son heure suprême,
le chat
avait retrouvé toute l'énergie de sa jeunesse ; il se débattit
contre le sbire
avec un reste de griffes et de dents ; mais il avait affaire à un agriculteur
bronzé sur l'épiderme, qui ne lâcha pas sa proie et la précipita
du haut
de la montagne, en gardant le sac par esprit d'économie. Cette
mauvaise action avait été commise dans un musée tout rempli de
reliques égyptiennes
et surtout de momies de chats, remontant à la domesticité des Pharaons. Un
an ou quatorze mois après, pour mieux dire, le gardien du musée,
rentrant à minuit,
entendit sur l'escalier une plainte aiguë et intermittente, qui lui causa
une certaine émotion. Puis, comme il jetait les yeux, par devoir d'inspection,
sur l'embrasure d'une fenêtre intérieure, il aperçut, dans la plus suppliante
des poses, le chat du Saut de Maroc... L'heure de la nuit fit croire à
une apparition de fantôme ; poltron comme tous les gardiens, il
allait tomber à
genoux et demander grâce, lorsqu'un reste de sentiment viril l'arrêta
: il trouva
plus honorable d'ouvrir lestement la porte de sa chambre et de s'y réfugier,
en s'y protégeant par des signes de croix. La
nuit fut mauvaise ; il dormit peu, et rêva que le Musée était assiégé
par des momies
lugubres, conduites par Champollion. Le
lendemain, à l'heure où les fantômes disparaissent devant le soleil,
on aperçut
le chat nonchalamment posé sur une natte, devant la porte du musée égyptien.
Il s'opéra tout de suite une réaction en sa faveur ; on lui accorda ses
grandes entrées ; on l'accabla de soins ; enfin, on le traita comme
un jeune chien
ou comme un jeune chat. Seulement, par intervalles, on entendait cette
exclamation
de surprise : -
Comment diable est-il revenu ! il doit être sorcier ! Le
plus étonné de tous fut le paysan bourreau ; il recula de trois pas,
croisa les
mains au-dessus de sa tête et exécuta la fameuse pantomime de Talma,
précipitant
les Gaulois du haut du Capitole, dans Manlius. Les
Gaulois ne revinrent pas chez eux : on les avait trop bien précipités. Rassuré
complètement sur son avenir, le vieux chat rajeunissait à vue d'oeil,
et se
livrait même, par boutades, à des ébats enfantins. Ces êtres, que
nous appelons
des animaux, parce que nous ne craignons pas la riposte, ont à un suprême
degré la conscience du malheur et du bonheur, et prennent toujours
des allures
et une physionomie conformes à leur état de fortune. Le chat
malheureux s'oublie,
se résigne, se néglige et adopte les airs d'un philosophe stoïcien,
qui
fait un perpétuel monologue sur les vicissitudes de la vie ; mais, si
un rayon
vient à luire, il secoue son indolence, cherche le soleil, se pavane
sur les
murs, relève ses oreilles, s'assoit fièrement en public, et se réhabilite
à ses
propres yeux en détachant de sa fourrure, avec le peigne de sa patte,
toutes les
souillures de la pauvreté. Ainsi
faisait le chat du Saut de Maroc ; on ne le reconnaissait plus,
tellement les
soins de la toilette l'avaient remis à neuf. A
cette époque, j'avais un logement dans le musée de Marseille, et
cette histoire
se passa sous mes yeux. Je fis tous les efforts possibles
d'imagination pour
m'expliquer ce retour, après une absence de quatorze mois, et j'en
causais même
souvent avec le directeur du Muséum d'histoire naturelle, mon ami Barthélémy
Lapommeraye, homme d'esprit, quoique très savant. Nous fîmes même
un jour
ensemble un pèlerinage au Saut du Maroc, et de cette hauteur, en
apercevant Marseille
si éloignée, si enveloppée de collines, de bastides innombrables et
de flots
marins, nous comprîmes moins que jamais de quels expédients le chat s'était
servi pour regagner sa maison. Je
me plais à m'acharner à la poursuite d'une idée comme à la
poursuite d'un mat aux
échecs ou d'un trick impossible au whist. Un jour, le hasard d'une succession
de pensées me mit sur la voie de la découverte, et je m'écriai,
comme l'illustre
géomètre : -
J'ai trouvé le problème ! Les
chats, comme les oiseaux, ont dans le sens de l'ouïe une délicatesse
de perception
dont notre sourde oreille humaine ne peut nous donner aucune idée. Or,
le chat du musée, mal précipité du Saut de Maroc, se raccrocha
probablement aux
pins et aux saxifrages qui hérissent la montagne ; revenu de sa
frayeur, et tenant
à la vie comme tous ceux de sa race, il songea sérieusement à
regagner la maison
témoin des jeux de son enfance, et d'où il avait été arraché par
un ennemi
extérieur. Ici
commence une odyssée qui supprime le génie inventif du héros d'Homère.
Ulysse
est l'homme des expédients vulgaires auprès de notre chat. Quant à
celui du
marquis de Carabas, c'est tout simplement un niais. J'aime mieux la façade
du Louvre
de Perrault. Le
chat n'avait jamais vu la mer, monstre immense, redouté de tous les
animaux de
la race féline, surtout des lions. Notre malheureux exilé s'écarta
au plus vite
de cette meute de vagues orageuses qui aboyaient au bas du précipice.
Parvenu
au sommet calme d'une montagne, il prêta l'oreille et entendit, au
lever de
l'aurore, un bruit lointain très connu de lui, le bruit d'une grande
ville qui
se réveille, le carillon des cloches, les roulements de tambour, le
fracas des
roues des charrettes qui se rendent au marché. -
La ville est là, de ce côté, a-t-il dit ; marchons vers son bruit ;
après, nous
verrons. La
campagne offre de grandes ressources aux chats pèlerins ; ils vivent
de chasse,
comme les sauvages Makidas ; le gibier abonde : il y a des sauterelles,
des
cigales, des rats des champs, des grenouilles, une carte très variée
enfin, comme
disent les affiches des petits restaurants parisiens. L'eau est à discrétion. A
côté de ces avantages, il y a de grands inconvénients : il y a les
chasseurs marseillais
qui, ne trouvant toujours qu'un gibier absent, se vengent contre le premier
chat venu ; il y a les paysans, jaloux de leurs garennes ; il y a les chiens,
qui se croient obligés d'aboyer à toutes les diligences et à tous
les chevaux
qui passent sur la route, et rendent ces parages fort dangereux ; mais
un
vieux chat qui sait se conduire flaire de loin tous ces périls, et
les tient à
distance avec un sûreté infaillible de coup d'oeil. Ensuite, le chat
est doué d'une
patience merveilleuse, il sait se blottir, tout un jour, dans un asile
reconnu
sûr, après un long examen de l'ouïe et de l'odorat ; il sait
attendre la nuit,
sombre mère de la sûreté, et son oeil phosphorique, illuminant les ténèbres,
le conduit sur des sentiers inconnus de ses ennemis. Notre
pauvre voyageur a donc franchi, sans encombre, la campagne, toujours
guidé par
le bruit de la ville, bruit qui s'est fait plus distinct chaque jour. C'était
beaucoup, sans doute, d'arriver jusqu'à la limite de l'octroi ; mais
il fallait
trouver une maison dans une ville de cent soixante mille âmes, qu'on avait
traversée une seule fois et dans un sac. Marseille
est une ville qui ressemble assez à Constantinople, à cause de l'abondance
de ses chiens errants. Tout marin a un chien auquel il est sincèrement
attaché ; mais, au moment du départ, il abandonne cet ami fidèle dans
une auberge, et l'animal, privé de son maître, passe sa vie à le
chercher dans
tous les quartiers de Marseille. C'est de la même manière que Constantinople
s'est peuplée depuis Mahomet II. Notre chat connaissait ce fléau errant
; car, pendant dix ans, du haut de la fenêtre du musée, il avait vu défiler
toutes les espèces canines, depuis le molosse de Laconie jusqu'au
King's Charles
; il fallait donc s'avancer avec une prudence méticuleuse, sonder le terrain
à tâtons, éviter le grand jour, ne se confier qu'aux ténèbres,
avoir l'oeil
ouvert sur les soupiraux des caves, vivre frugalement, se contenter de
peu,
comme le rat d'Horace, contentus parvo, enfin, changer de domicile
tous les jours
avant l'aube, pour se rapprocher davantage de la maison et gagner du terrain
vers le but. Le
moment est venu de dire sur qui comptait le chat voyageur. Un
grand fracas, mêlé de tous les bruits, de tous les murmures, de
toutes les clameurs,
lui avait fait connaître le point de l'horizon où se trouvait la grande
ville. Une fois arrivé dans Marseille, il comptait sur un bruit particulier
et bien connu, qui devait lui signaler le quartier où fut son berceau.
Tant qu'il n'entendait pas ce bruit spécial, il fallait marcher, marcher
toujours, loin des chiens, loin des hommes, loin des enfants, loin du jour. Le
musée de la ville possède une horloge qui a le privilège de sonner
toujours quelque
chose. Les heures ne lui suffisent pas. Elle sonne les quarts et les huitièmes,
et fait même précéder chaque sonnerie d'une légère cavatine d'avertissement.
On est prévenu, on écoute. Le conseil municipal alloue dix francs
par an à M. Charlet, directeur de cette horloge. A la discussion
annuelle du
budget, quelques membres, ennemis des abus, réclament une réduction
pour combler
le vide que les cinquante millions du canal de dans
le trésor municipal. Pendant
dix ans, notre chat voyageur avait entendu retentir cette horloge verbeuse
au-dessus de sa tête. A l'âge de la jeunesse, il avait joué tant de
fois
avec les plombs de cette horloge et arrêté ses mouvements, au grand désespoir
de M. Charlet, qui tremblait alors pour sa réduction, en écoutant le
silence
inexplicable de sa fille. Tant que notre pauvre chat, errant de cave
en cave,
n'entendait pas la sonnerie du toit paternel, il se disait à lui-même
: -
Je ne suis pas dans le quartier, allons plus loin. Et,
sans impatience, sans découragement, il se remettait en route avec
les mêmes précautions
dans les ténèbres, prêtant l'oreille aux horloges, et n'entendant jamais
la sienne, celle qu'il aurait reconnue dans un concert de tous les clochers
italiens. Le
hasard, qui ne sert jamais les malheureux, aurait pu conduire plus
vite l'animal
errant dans une bonne direction, et lui épargner bien des mauvais
jours ;
mais, en appréciant la durée de l'absence, quatorze mois, il est
permis de supposer
qu'il aura pris le plus long chemin, et qu'il n'est arrivé enfin dans
le
quartier du musée qu'après avoir parcouru tous les carrefours de la
vieille ville. Alexandre,
Annibal, Fernand Cortès, Robinsons Crusoé, ont dépensé beaucoup
moins d'intelligence
et de ruses de guerre que ce chat, dans sa campagne de douze mois.
S'il avait pu écrire son odyssée, il n'y aurait pas de lecture plus émouvante.
Le nombre de périls qu'il a conjurés, le nombre de calculs qu'il a faits
doit être prodigieux. Et lorsque enfin il a entendu dans le lointain,
à minuit,
la sonnerie prolongée de son horloge, tout ne finissait pas pour lui
; il
avait encore bien du chemin à faire et beaucoup de batailles à
livrer aux chiens.
D'abord, il ne fallait pas se laisser emporter étourdiment par une
joie dangereuse
; si près du but, il ne fallait pas compromettre la réussite par
trop de
précipitation. Un homme aurait échoué en pareil cas ; l'animal,
sans avoir lu le
moindre chapitre sur les dangers de l'exaltation étourdie, a manoeuvré
comme le
premier jour ; il a maîtrisé les émotions de cette joie fatale qui
met un voile
sur les yeux et fait échouer au port ; il n'a rien voulu donner au
hasard, même
à sa dernière étape, à son dernier ruisseau, à son dernier mur,
à son dernier
pas ; et il est arrivé sain et sauf. Quelle leçon pour l'homme qui arrive
aux sottises par la réflexion ; qui apprend les mathématiques pour soutenir
que 2 et 2 font 5, et étudie des cartes de géographie pour se briser
contre
un écueil. Mon
histoire finie, on me demanda quel rapport on pouvait établir entre
l'odysée du
chat et la perruche envolée. Je répondis que le temps n'était pas
venu d'établir
ce rapport, mais qu'il viendrait tôt ou tard. On me questionna de nouveau
sur la suite de l'histoire du chat du musée ; je répondis qu'elle n'avait
pas eu de suite, et même qu'elle avait été presque oubliée, à
cause d'une
autre histoire survenue dans le même établissement, et qui absorba l'attention
des naturalistes. La
perruche fut oubliée à son tour, et on voulut connaître cette
nouvelle histoire. -
Celle-ci, repris-je, n'a aucun rapport avec la perruche envolée,
dirait un naturaliste
de profession. J'ose soutenir le contraire, et je crois qu'elle s'y rattache
par un côté, comme j'espère vous le démontrer quand la perruche
sera rentrée
dans sa cage. Un
signe général d'incrédulité accueillit cette dernière phrase. Je
proposai de nouveaux
paris ; on se tut, et ce silence attendait l'histoire promise.
II. Castor et Pollux. Le tombeau de Milon. Les chiens Lazzaroni. Le
crime et le châtiment. La langue des bêtes. Revenons à ma perruche.
-
Cette fois, dis-je, il s'agit de deux chiens du musée ; on les
nommait Castor et
Pollus, quoiqu'ils ne fussent pas frères. Castor était un vrai
molosse ; Pollux,
un jeune caniche de très petit taille. Ils étaient liés d'une étroite
amitié,
comme les deux frères d'Hélène dont ils portaient les noms. En général,
les
animaux connaissent l'amitié ; bien plus, quand ils sont unis, ils ne
se brouillent
pas. Le lion vit avec le chien dans la même cage, et ces deux amis ne
se
querellent jamais ; ce qui prouve encore la supériorité de l'homme
sur les animaux. Castor,
le molosse, avait contracté l'habitude de faire sa sieste, en été,
dans un
tombeau de pierre froide, qui est exposé dans le musée, et qui,
dit-on, a renfermé
les restes de Milon, le meurtrier de Clodius, le client de Marcus-Tullius
Cicéron, l'illustre exilé de Rome. Excusez cette érudition facile et
inopportune. Pollux
ne faisait pas de sieste, lui ; il s'acquittait de son devoir de
gardien ;
il se promenait dans le musée des sarcophages et surveillait les étrangers,
pour
aboyer en cas de vol d'antiquités phocéennes. Il était très fier
de son emploi,
et lorsqu'on fermait les portes du musée et que tout s'était passé conformément
aux lois, il se présentait avec joie devant le concierge, pour recevoir,
comme gratification, une caresse de sa main. Un
jour, à l'heure de la sieste, il n'y avait pas l'ombre d'un étranger
devant les
sarcophages et les plâtres du musée phocéen ; Pollus, ne redoutant
aucun vol,
sortit sur la place pour se délasser de ses travaux d'inspection et
engager une
partie de soubresauts avec quelque jeune chien de son âge, ami du
jeu. La
place du musée était déserte, à cause d'une chaleur de trente degrés
Réaumur ;
mais il y avait beaucoup de chiens, selon l'usage. C'était avant
l'invention de
la charrette municipale qui enlève du pavé l'espèce hydrophobe,
dans la chaude
saison. Les uns passaient rapidement, comme si des affaires
importantes les
eussent appelés ailleurs ; les autres se promenaient sans but, comme
des péripatéticiens
quadrupèdes ; on en voyait sous les arbres, qui dormaient comme des
lazzaroni, ou qui se regardaient deux à deux, comme des chiens sculptés
sur les
pilastres d'un portail. Le jeune Pollux, ne voyant que des amis dans
ce club en
plein air, cherchait un joueur ; mais son apparence de chien
aristocrate réveilla
les haines jalouses de cette meute indigente ; on répondit par des grognements
sourds à ses propositions amicales, et le plus hargneux de tous tomba,
les dents en relief, sur Pollux, le terrassa et faillit le tuer sur place.
Les autres chiens assistèrent à cette scène dans une stoïque tranquillité. Pollux
s'échappa de la mâchoire de l'assassin, secoua sa toison dévastée,
et, en quelques
bonds, il avait atteint le seuil de son établissement. Sans s'arrêter
devant
le concierge, qui ne l'aurait pas compris, il marcha droit à la salle
des sarcophages,
mit ses deux pattes antérieures sur le tombeau de Milon, et fit sortir
de son gosier quelques notes pleines d'expression et de voyelles lamentables. Castor
se leva lentement, bondit hors du tombeau, aiguisa ses pattes sur les dalles,
acheva de se réveiller, jeta un regard oblique sur Pollux, et prit,
avec le
calme de la force, le chemin de la grande porte du musée. Arrivé sur
le seuil,
il s'arrêta brusquement, s'assit sur lui-même et attendit Pollux. En
ce moment, que se passa-t-il ? quel échange de paroles fut fait ? La
science ne
peut le savoir ; mais voici ce qu'il advint. Castor,
après avoir acquis la certitude de ne pas frapper l'innocent pour le coupable,
quitta sa pose d'Hercule au repos, et marcha seul, d'un pas tranquille,
vers l'assassin de Pollux. Ce ne fut pas un combat, ce fut une exécution
; le coupable roula dans la poussière et l'ensanglanta. Le châtiment
donné,
Castor reprit le chemin du musée, où Pollux l'accabla de caresses et
de cris
de joie. Le molosse vengeur accepta ces démonstrations amicales avec froideur,
comme pour montrer qu'il ne croyait pas le remerciement nécessaire après
un si léger service ; et il rentra dans la salle pour achever sa
sieste au fond
du tombeau de Milon. Dans
l'Histoire des Chiens célèbres, je ne trouve rien de comparable à
cette scène
de Castor et Pollux ; il m'a été donné de la voir, et ceux qui
l'ont vue comme
moi ne peuvent encore l'expliquer. Il faut nécessairement admettre ce
que j'admets,
moi, que ces deux chiens avaient une sorte de langue pour se communiquer
leurs pensées ; il faut admettre que Pollux a dit à Castor : -
Un chien énorme vient de m'assassiner, là, sur cette place. Ce
n'est pas tout ; il faut admettre une chose encore plus répulsive à
la raison ;
il faut croire que, sur le seuil du musée, Castor a demandé : -
Où est-il ? et que Pollux a clairement désigné son assassin dans
une meute de chiens
de toute taille et de toute nuance. Pollux aurait répondu : -
C'est ce grand braque qui a trois taches de feu. Certainement,
la langue que murmurent les animaux, lorsqu'ils vivent ensemble, n'a
aucun rapport même avec la plus imparfaite des langues primitives des
sauvages
; mais elle leur suffit telle qu'elle est pour les besoins de leur association
; son vocabulaire est très borné ; il se compose de quelques modulations
plus ou moins vives, qui ont un sens très clair entre deux animaux depuis
longtemps amis. Je développerai un jour ce système en l'appuyant d'observations
que j'ai faites, et qui le compléteront. Au reste, la sagesse indienne,
en inventant les fables et les dialogues d'animaux, a donné à
quelques anciens
la première idée de ce système ; ainsi, je me garderais bien d'en réclamer
les droits d'auteur. Après
l'histoire de Castor et Pollux, mes amis voulurent remettre
l'entretien sur
le chapitre de la perruche ; mais une simple observation coupa court
au sujet. -
L'histoire de la perruche commence, leur dis-je ; elle se fait ; nous
allons la
suivre dans l'air. Ainsi, attendons ; préparez vos paris perdus et
parlons de Sébastopol.
III. Aventures et pérégrinations. La cloche de Saint-Leu. Grande Nouvelle. Je prends la pose de Napoléon à Austerlitz. Une
Pie. Duel sur un cerisier. Les formidable.
Le siège du clocher. La voix de l'horloge. Insomnie de ma perruche. Immense bataille. Retour à la cage. En
venant se percher sur les arbres des Plessis, la perruche avait fait
un grand pas
rétrograde ; à mon avis, elle manifestait une tendance évidente à
se rapprocher
de Saint-Leu. Le souvenir du Musée de Marseille ne me laissait aucun doute
sur le dénouement. Les
perruches ont un don bien rare chez les hommes ; elles savent écouter,
elles aiment
écouter. Chez ces oiseaux, le sens de l'ouïe absorbe continuellement,
et, s'ils
avaient une complète conformation de ressorts dans l'organe de la
parole, Dieu
sait tout ce qu'ils apprendraient par coeur et tout ce qu'ils
rediraient. Malheureusement,
le mécanisme de la prononciation est très borné dans leur bec, et
leur répertoire est peu varié. Malgré cette insuffisance de moyens,
les perruches
se croient obligées de prêter une oreille attentive à tous les
bruits extérieurs,
et ce que les autres animaux écouteurs font par crainte d'un péril, les
perruches le font par leur instinct, qui est l'amour de l'audition. De
tous les bruits extérieurs qui frappaient plusieurs fois par jour les
oreilles
de la perruche, notre héroïne, le bruit de la cloche de l'église était
le
plus retentissant. Elle se réveillait au premier angelus, elle
s'endormait après
le dernier. Probablement, elle doit avoir fait quelques tentatives de gosier
pour répéter la sonnerie ; mais elle n'a pas réussi, ce qui lui a
donné encore
plus d'estime et d'affection pour cet inimitable voisin. Du
haut des arbres des Plessis elle a entendu cette voix du clocher,
comme une voix
domestique qui l'appelait à la cage, et elle a obéi, sans prévoir,
hélas ! les
tribulations qui l'attendaient et qui ont eu pour témoin tout le
village de Saint-Leu. Au
parc de Boissy, elle n'entendait pas la cloche de son village ; aussi a-t-elle
fait un assez long séjour sur les arbres de ce château. Pourquoi a-t-elle
quitté ce paradis terrestre, où rien ne lui manquait, où rien ne la
troublait
? Ici est un mystère, et j'ai essayé de l'approfondir. Son instinct lui
disait bien qu'elle était dans le vrai domaine des perruches, dans
une belle forêt
indienne, sous un ciel chaud ; mais elle cherchait aux environs tout
ce que
cette nature maternelle devait lui donner, à savoir, des perruches
sur les branches,
des cannes à sucre, des rizières et des singes pourvoyeurs. Au lieu
de cela,
qu'a-t-elle vu ? Une bande d'enfants, pris pour des singes, qui émiettaient
du pain sur le gazon et ne montaient jamais sur les arbres. Il y avait
de quoi bouleverser un cerveau de perruche. Aussi, pour se délivrer
de ce tableau
qui troublait son instinct, elle a pris son vol au-dessus des arbres
du château,
et, ayant aperçu dans le lointain l'oasis des Plessis, au centre
d'une plaine
de blé mûr, elle a déménagé tout de suite, et c'est là qu'elle a
entendu la
cloche de Saint-Leu. Un
matin, M. Adrien, l'habile chorégraphe de dit
: -
Tout le village est en rumeur ; la perruche est dans le clocher de l'église
! S'il
est permis de comparer les petites choses aux grandes, comme dit le poète
divin,
je pris la pose stoïque donnée à Napoléon par le peintre Gérard
dans le tableau
de comme
une nouvelle inattendue, la victoire. L'Empereur le regarde et semble
lui dire
: - Je la connaissais avant vous. Nous
descendîmes sur la place de l'église ; la foule y accourait.
Saint-Leu n'avait
jamais vu de perruche ; c'était un événement. Tous les yeux
arpentaient le
clocher, depuis la base jusqu'à son coq doré, servant de girouette ;
mais personne
ne voyait une plume verte. Cependant le doute n'était pas permis ; plusieurs
personnes dignes de foi, entre autres le gardien des tombes de l'église,
M. Decroix, son plus proche voisin, et M. Thomas Chassain, propriétaire
de l'hôtel de passé
la nuit dans la cage du clocher, mais qu'il courait probablement la campagne
à cette heure. La
foule s'obstina toujours à regarder le clocher. Cette
conduite de l'oiseau était naturelle ; il était accouru à une voix
connue, qui
lui rappelait tant de festins et de friandises ; mais, n'ayant trouvé
aucune main
généreuse à côté de la voix, il avait fallu songer à se mettre
en quête du repas
du matin. L'appétit de ces oiseaux est impatient du moindre retard. On
sait que le village de Taverny est la continuation de Saint-Leu ; ces
deux localités
pourraient avoir le même nom. Or, ce jour-là, M. Fallet, boulanger
à Taverny,
se promenant dans son jardin, entendit un grand bruit d'ailes et de feuilles
du côté d'un cerisier, et, avançant avec précaution, il assista de
très près
à un curieux spectacle, dont il nous a fait le compte rendu. Son récit
nous permet
de supposer que les choses se sont passées comme nous allons les décrire
pour
les besoins de l'anecdote. Avec
cette promptitude de coup d'oeil dont jouissent tous les oiseaux, même
dans leur
vol le plus rapide, la perruche découvrit un arbre coloré à
l'indienne ; c'était
un cerisier chargé de fruits. Le rouge est l'aimant d'un bec. Notre héroïne
s'abattit sur cet arbre, qui lui rappelait le caquier de l'Inde. Elle éprouva
sans doute une joie vive en voyant flotter autour d'elle ces grappes savoureuses
de rubis, qui promettaient un festin inépuisable. Les oiseaux ont aussi
leurs destinées ; habent sua fata. Le bec de la perruche s'ouvrit et
se referma
; un frisson la saisit ; elle aperçut devant elle un oiseau qui ne parlait
pas sa langue. Chez les animaux comme chez les hommes (avant 1815),
tous ceux
qui ne parlent pas la même langue sont ennemis. C'était une pie, qui
venait exercer
son métier de voleuse sur les cerises de M. Fallet. La gazza ladra
prit la
perruche, oiseau inconnu, pour un gendarme vert, et se précipita sur
elle pour
la poignarder d'un coup de bec. Les deux armes rostrales de ces deux oiseaux
ne sont pas de même dimension ; c'est le sabre court du dragon, croisé
avec
la lance du Cosaque. Notre perruche soutint bravement l'honneur de son
uniforme
; elle se servit d'une branche épaisse comme d'un bouclier, et, n'exposant
pas une plume au bec de son ennemie, elle dardait vivement le sien et le
retirait avec la promptitude de l'éclair, genre d'escrime qu'aucun maître
ne lui
avait appris et qui aurait étonné Grisier. Cette lutte dura un long
quart d'heure,
et M. Fallet lui donna le même intérêt qu'un Espagnol eût accordé
à un combat
de taureaux. Désespérant
de vaincre et craignant d'être vaincue, la pie s'envola vers la forêt,
et la perruche, rajustant ses ailes et ne se croyant pas en sûreté
sur les
feuilles de cet arbre, chercha un asile à Saint-Leu,
où les arbres et les eaux ne manquent pas. Pendant
une semaine, la perruche cacha ses jours dans les verts massifs de la Chaumette
; elle craignait les pies ; mais tous les soirs, après l'angelus,
elle regagnait
son gîte du clocher, espérant y trouver sa cage chérie, si
follement abandonnée
pour cette illusion trompeuse qu'on appelle la liberté des champs. Elle
donnait ainsi à chaque instant un démenti à cette fameuse maxime :
une liberté
orageuse est préférable à un esclavage tranquille liberté
lui devenait intolérable, et elle aurait donné toute la vallée de Montmorency
pour son petit ermitage grillé, où elle recevait tant de caresses, de
sucreries, de graines de tournesol, sans le souci du lendemain. Elle
avait adopté
cette autre maxime du peuple qui passe de l'anarchie à la dictature :
la sécurité
vaut mieux que la liberté. Hélas
! notre jeune héroïne devait... mais n'anticipons pas sur les événements,
comme
disait le bon Ducray-Duminil, à l'âge d'or du roman, in-12, mal
imprimé sur
papier gris, mais sentimental. A
cause de son éloignement du chemin de fer, le village de Saint-Leu a
conservé les
privilèges agrestes des hameaux de Gessner et de Florian. Toutes les hirondelles
de la vallée de Montmorency, effrayées par les wagons, les sifflets et
la fumée noire, se sont réfugiées sous les toits paisibles de
Saint-Leu. Là elles
goûtent le repos des anciens jours ; elles bâtissent leurs nids , établissent
leurs familles, et ne craignent pas qu'un convoi brutal vienne emporter
tous ces bonheurs domestiques, célébrés par Florian. A Saint-Leu,
on peut
encore chanter la romance ; Que
j'aime à voir les hirondelles A
ma fenêtre, tous les ans, etc. Dans
la grande rue de Saint-Leu, ces jolis oiseaux, si bien décrits par Toussenel,
notre grand naturaliste, sont si familiers, qu'ils deviennent dangereux
; sous prétexte d'annoncer la pluie aux agriculteurs, ils rasent joyeusement
la terre, et, dans leur vol étourdi, ils effleurent d'une aile aiguë
les
joues et les yeux des passants qui ne sont pas agriculteurs. A cet inconvénient
près, rien n'est charmant comme le jeu vif de ces filles de l'air, de
ces sylphes d'avril, de ces éclairs ailés. Les
hirondelles se méfient des clochers, et leur instinct maternel a bien
raison ;
elles savent que, dans les trous de ces édifices, logent des
nocturnes oiseaux de
proie qui ravagent les nids et font pleurer les mères à l'ombre des peupliers,
populeâ sub umbrâ. Les oiseaux sont toujours en pays ennemi, et ils ne
sauraient prendre trop de précautions. Les
hirondelles d'âge mûr avaient visité le clocher de Saint-Leu, et le
résultat de
l'enquête était satisfaisant : un clocher tout neuf, bâti en 1850,
aux frais du
prince Louis-Napoléon ; un bijou de clocher à mettre sous cloche.
Pas une crevasse,
pas une fissure, pas un domicile pour un hibou. Nicticorax in domicilio,
comme dit le psalmiste. Il n'y avait donc rien à craindre pour les nids
et les oeufs de ce côté, au moins pendant un demi-siècle ; et on
voyait la mère
se réjouir de ses enfants, matrem filiorum lætantem. Tout
à coup, une hirondelle, la première de toutes, celle qui n'avait pas
fait le
printemps, une hirondelle levée avec l'aurore, rase le clocher neuf,
et aperçoit
un oiseau vert, non classé dans l'ornithologie de Saint-Leu, secouant
à l'air
ses plumes humides, et aiguisant un bec crochu sur une clef d'ogive.
Il fallait
bien admettre le péril ; c'était, pour l'hirondelle, un hibou déguisé,
un
hibou malin qui se peignait en vert pour tromper l'espion.
L'hirondelle sonna l'alarme
et cria le danger sur les toits ; une étincelle électrique courut
sur deux
corniches de nids ; on tint un conseil d'ancêtres, au pied d'une
cheminée ; on
prêcha la croisade contre l'oiseau de proie du clocher. La
perruche ne se doutait nullement de ces alarmes ; elle cherchait
toujours sa cage,
et vint se percher sur le toit de l'hôtel de s'arrêtent
les omnibus du chemin de fer. Ainsi posée, dans un isolement absolu, elle
ressemblait à cet oiseau dont parle l'Écriture, passer solitarius in
tecto. A
cet instant, une grêle noire d'hirondelles tombe sur le même toit
avec des cris
aigus ; tous les enfants de Saint-Leu prennent parti pour la perruche,
et battent
des mains pour épouvanter les hirondelles. Notre héroïne montre le
bec aux
oiseaux du printemps, lesquels, ne se croyant pas en force contre un
pareil bec,
battent en retraite et vont chercher des renforts pour faire le siège
de la perruche.
Dans le village, tous les travaux sont abandonnés ; chacun veut assister
à la bataille ; on nous envoie une dépêche télégraphique ; nous accourons
pour faire entendre notre voix et jouer le rôle de l'Autriche... La perruche
s'effraye de ce concours de peuple, elle plonge du toit, et se perd dans
l'épais massif d'un noyer qui est dans la cour de l'hôtel de la Croix-Blanche. Une
perruche sur un noyer chargé de noix crevassées, c'est comme un
avare en pleine
mine californienne ; notre héroïne ne se possédait pas de joie ;
elle avait
oublié les pies, les hirondelles, les cerisiers ; elle avait trouvé
un restaurant
éternel. On
vit courir au même instant un nuage noir sur la ligne des toits : c'était
un vol
effrayant d'hirondelles ; ces oiseaux montrèrent beaucoup de courage
quand ils
ne trouvèrent pas l'ennemi ; ils visitèrent le toit de sondèrent
de l'oeil les cheminées ; ce devoir accompli, le vol se dispersa, et chaque
famille rentra dans son lit suspendu. Nous
avons pu étudier les hirondelles dans cette occasion, et nous avons
compris qu'elles
n'avaient nullement l'intention d'attaquer le redoutable oiseau ; leur
plan
de campagne n'avait au fond rien de belliqueux. Elles voulaient se réunir
en
masse compacte, effrayer l'ennemi et le chasser du territoire de
Saint-Leu, propriété
exclusive des hirondelles. Si
le rare souvenir de la cage n'eût pas troublé de temps en temps
notre perruche,
son existence commençait à prendre toutes les conditions du bonheur.
Que
lui manquait-il ? elle avait un noyer, à la fois retraite sûre et
table délicate
; et, la nuit, elle avait un gîte dans le clocher. Elle
a passé douze jours dans le noyer de souvent
rôder autour de l'arbre, dans l'espoir de la ramener en lui faisant entendre
des voix amies ; elle ne reconnaissait pas ces voix, qui n'avaient jamais
retenti à ses oreilles au grand air de la campagne, et perdaient,
autour du
noyer, la gamme intérieure du salon. Les
animaux sont tous fort reconnaissants des services rendus. La
reconnaissance est
fille de l'instinct, l'ingratitude est fille de la raison. Bien plus,
les animaux
n'ayant pas, comme nous, la perception nette des objets extérieurs,
sont reconnaissants
envers tout ce qui les oblige, hommes ou choses. Ainsi, notre perruche
regardait son noyer et son clocher comme deux bienfaiteurs ; l'un la garantissait
contre les dangers de la faim, l'autre contre les dangers de la nuit.
Chaque jour augmentait ce sentiment de gratitude ; et l'oiseau,
instruit d'une
longue expérience de douze jours et ayant mieux réglé sa vie, et connaissant
mieux ses goûts et ses chemins, évitait de se montrer au crépuscule
du
matin et du soir, sur les aspérités saillantes du clocher, de peur
de provoquer
une seconde fois la formidable insurrection des hirondelles de Saint-Leu. Oui,
faites des projets d'avenir en ce monde ; l'imprévu est toujours là,
embusqué
sur votre route, et il bouleverse tout. Si
nous n'avions, comme garants de notre récit, tous les habitants d'un
village voisin,
nous n'oserions écrire la suite de cette histoire ; d'ailleurs, il y
a des
péripéties qu'il est impossible d'inventer, si le hasard ne les
invente pas. Aucun
mensonge de fabuliste ne se glisse dans notre récit. Jamais histoire
ne mérita
mieux son nom. Le
conseil municipal de Saint-Leu avait voté la dépense d'une horloge
magnifique pour
le clocher de l'église ; une horloge de ville, une horloge sérieuse,
signée Lepaute,
comme celle qui a l'honneur de se faire entendre au Louvre, entre les statues
de Jean Goujon. Cette
horloge, complément nécessaire de la jolie église de Saint-Leu,
devait débuter
le jour de la fête du village ; fête charmante, encadrée par la
belle place
de la mairie, et ombragée par la forêt voisine, qui prête ses
arbres aux promeneurs. Un
soir, après huit heures, la perruche quitte son noyer chéri, et va,
selon l'habitude,
s'établir sous une corniche du clocher ; elle avait mis le bec sous l'aile,
et dormait tranquille, comme au désert, sur la pierre d'une pagode, inaccessible
aux serpents, ces nocturnes ennemis des oiseaux, lorsqu'elle fut réveillée
en sursaut par une voix inconnue qui éclatait sous ses pattes : c'était
l'horloge !... Elle sonnait, pour la première fois, neuf heures, et
avec cette
plénitude de moyens qui accompagne toujours un ténor vierge de si bémols
et
une horloge encore exempte d'humidité. L'inconnu
est effrayant pour les hommes, et surtout pour les oiseaux. A leur apparition,
le feu grégeois, le canon, et l'arquebuse à croc ont épouvanté les
plus
braves. Notre perruche bondit neuf fois sous l'ogive, et trembla convulsivement
de toute la longueur de ses plumes. Cependant, comme elle comptait
sur l'amitié jusqu'alors si fidèle de son clocher protecteur, elle
crut avoir
mal entendu, ainsi qu'il arrive souvent chez nous, lorsqu'un ami nous décroche
une première épigramme en public. Avant de se brouiller, on attend
la seconde.
Notre pauvre oiseau attendit donc, et son ami le clocher redevenant muet
et bon, elle se rendormit. Au coup de dix heures, elle se réveilla
encore en
sursaut, et le silence de la nuit augmentant l'intensité du son, elle
se crut brutalement
expulsée de son asile, et se laissa tomber, demi-morte de frayeur, sur
un toit voisin. Cette nuit fut terrible. Pour comble de malheur, les
jeunes Parisiens
qui sortaient du bal de la fête traversaient la rue, en hurlant avec mélancolie
ce qu'on appelle de gais flonflons. Il y avait de quoi perdre la tête
pour
une simple perruche destinée à la vie des solitudes indiennes. Les
douze coups
de minuit, éternellement répétés par l'écho de la montagne, complétèrent
la
désolation du malheureux oiseau. Il lui paraissait désormais
impossible de se réconcilier
avec un clocher qui la poursuivait dans son repos par une obstination
si évidente. Il n'y avait plus d'asile pour elle, plus de protection,
plus d'ami. Les premières lueurs de l'aube la trouvèrent pâle d'insomnie
et de terreur sur la gouttière de la maison de M. Maréchal. Le
jour qui allait suivre devait continuer les angoisses de la nuit. Ce
fut encore une hirondelle qui donna l'alarme, en apercevant le
terrible oiseau
dans le domaine sacré des nids. Cette fois, les oiseaux du printemps résolurent
de frapper un coup décisif. On
envoya des ambassadeurs aux hirondelles du village de Taverny ; on
proposa une
ligue offensive et défensive ; il s'agissait des intérêts généraux
de la grande
banlieue, menacés par un Attila vert et d'autant plus redoutable
qu'il était
seul. Dans
un instant, un nuage d'hirondelles couvrit Saint-Leu, et, chose étonnante
! cette
armée, la plus nombreuse que les hirondelles aient mise sur pied,
n'osa point
attaquer la perruche ; c'était toujours le même système, le même
plan. L'oiseau,
qui ne se croyait pas si redoutable, s'effraya, prit son vol au hasard
et
se perdit dans un immense tourbillon d'hirondelles ; un calcul de
chasseur expert
évaluait leur nombre à trois mille. Tout le village était en émoi
; on s'attendait,
à chaque instant, à voir la perruche tomber morte du haut du nuage ennemi
; cet étrange combat d'une multitude contre un seul être dura tout
un jour
; ce fut un jour férié pour Saint-Leu. On suspendit la récolte des
fruits ; on
oublia les soins du ménage et de l'agriculture. Tous les yeux, détachés
de la terre,
regardaient la mêlée orageuse du ciel ; c'était l'inverse des jeux
du Cirque
; la lice s'arrondissait dans les sommités de l'air, le drame se
jouait sur
la tête du parterre. A tout moment, de nouvelles recrues arrivaient,
car les cris
d'alarme avaient retenti sur les nids de Franconville, de Saint-Prix, d'Ermont
et de toute la ligne du chemin de fer. Quand le nuage s'abaissait, on voyait
la perruche héroïque distribuant des coups de bec aux téméraires
qui l'approchaient
de trop près. Il n'y a qu'un exemple d'une pareille défense dans l'histoire
: c'est Alexandre le Macédonien luttant seul, dans la ville des Oxidraques,
contre une nuée d'ennemis, et encore le héros de Macédoine était cuirassé
de pied en cap, ce qui met la comparaison à l'avantage de la perruche
de
Saint-Leu. Enfin,
notre pauvre héroïne ayant épuisé ses forces dans une lutte
surhumaine, et
ne trouvant plus de soutien dans le mécanisme usé de ses ailes, fit
un effort suprême
; elle perça la ligne inférieure de l'ennemi et tomba, en tournoyant,
sur
le toit de la maison de M. Maréchal. Là, résolue d'attendre la
mort, elle enfonça
son bec dans une gouttière et se voila de ses ailes, comme César de
son manteau. M.
Maréchal prit une échelle, aux applaudissements de tout le village,
monta sur le
toit de sa maison et s'empara de l'oiseau sans éprouver la moindre résistance. Nous
n'avons pas assisté à cette lutte dernière ; elle nous a été
racontée par M.
Lucien Pigny, le propriétaire des bains charmants de Saint-Leu. Nous
vîmes, avec
joie, arriver M. Adrien et M. Maréchal qui rapportaient la perruche
au milieu
de tous les enfants du village. L'oiseau fut aussitôt replacé dans
sa cage
; il secoua ses plumes, prit un bain d'eau fraîche, poussa un cri
joyeux, et,
avec cette heureuse insouciance, privilège des oiseaux, il tendit le
bec à un
grain de sucre, le prit avec sa patte comme avec la main, et continua
sa vie de
perruche esclave, absolument comme si rien ne l'avait interrompue dans
sa douce
sérénité. L'armée
des hirondelles est rentrée dans ses quartiers. Le calme est rétabli
partout.
Le souvenir de ces événements subsistera longtemps à Saint-Leu ;
ils ont
déjà fait et feront encore l'entretien des longues veillées de
l'hiver.
|

Frontispiece, titelpagina en illustratie van de eerste editie (1862) - ill. door Morin
|
| 1866, 17 juni | Joseph Méry overlijdt in Parijs | |
|
|
||


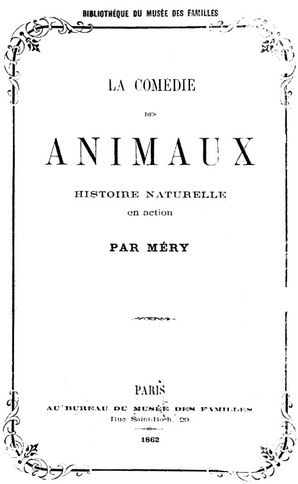
 \
\